L’histoire de France, telle qu’on nous l’a enseignée, est surtout l’histoire des pouvoirs successifs qui ont conduit notre pays et celle de leurs relations internationales, dont on ne retient hélas que les victoires militaires et non les erreurs qui les ont provoquées.

L’histoire locale, telle qu’elle a été vécue par un paysan du Larzac, de la Champagne Berrichonne ou même de la Vallée de Montmorency est très différente de celle d’un parisien. Il est très intéressant d’observer le comportement des hommes dont le nom est resté ancré dans nos communes valmorencéennes.
Jusqu’en 1789 le pouvoir est centralisé par le roi de France, monarque absolu de droit divin. Il choisit ses ministres, déclare la guerre, signe la paix et légifère à son gré. Il s’appuie sur deux piliers : le clergé et na noblesse qui lui assurent le salut de l’âme et la sécurité militaire. En vallée de Montmorency les membres de ces deux ordres sont sous l’autorité de l’Abbaye de Saint-Denis d’une part, et des Ducs de Montmorency, puis des Princes de Condé d’autre part. Ces deux ordres rivalisent pour étendre leur pouvoir, mais aussi pour créer de la richesse en aménageant toutes les terres de la vallée et les cours d’eau, en asséchant les marécages, en exploitant les carrières de gypse, etc. C’est sous leur influence que notre vallée est devenue le plus grand vignoble d’Europe.
La noblesse, où s’opposent nobles de race et nobles de fonction, possède presque toutes les terres cultivables, divisées en fiefs. Dans chaque fief, un seigneur, qui a fait aveu au Duc de Montmorency ou au prince de Condé, rend la justice et fixe les charges des terres concédées aux paysans. Le seigneur se réserve bien sûr les meilleures ; ses vignes sont nommées clos (car entourée d’une palissade), et il a l’exclusive propriété des pressoirs et étangs. Il perçoit des péages levés sur les personnes, les animaux ou les marchandises, des droits banaux pour l’utilisation du four, du moulin et du pressoir.
Les bénéfices tirés de leurs exploitations viticoles, mais aussi de leurs affaires dans la capitale leur permettent de faire construire des châteaux somptueux entourés de grands parcs. Joseph-Florent Le Normand de Mézières, seigneur d’Eaubonne mais aussi aménageur du Faubourg Poissonnière, fait ainsi construire trois châteaux par l’architecte Nicolas Ledoux, son comparse dans ses affaires parisiennes, sur le modèle du Petit Trianon ou du pavillon de musique de Louvecienne.
Donc d’énormes privilèges, qui nous paraissent aujourd’hui révoltants, qui vont perdurer jusqu’à ce que la Révolution éclate.
Mais, les philosophes des lumières avaient pourtant contesté l’autorité du roi ?

Les philosophes des lumières avaient en effet remis en cause l’absolutisme du roi et son origine divine. En 1748 Montesquieu, dans L’esprit des lois, avait développé la théorie de trois pouvoirs séparés : exécutif, législatif et judiciaire. En 1762 Rousseau, qui vit à Montmorency, va plus loin dans Le contrat social puisqu’il affirme la souveraineté du peuple et les vertus de la démocratie. Cet écrit lui vaudra d’être exilé.
Le principal soucis du roi était l’état des finances royales. Pour essayer de réduire la fraude fiscale Louis XVI décida d’encercler Paris par un mur de 24 km percé de 65 postes de péages, les Propylées. Le but était que personne ne puisse échapper au paiement des droits perçus aux entrée de la ville (taxes sur le charbon, la paille, le bois, le vin, les fruits cuits, la viande dépecée, le gibier, la volaille). Il fit appel à l’architecte Nicolas Ledoux qui édifia des construction monumentales, véritables joyaux architecturaux et fort coûteux. La superbe rotonde de la Villette était l’un de ces 65 édifices, tous différents et aussi imposants. L’opinion publique n’apprécia pas du tout ces péages coûteux et Louis XVI fut contraint à faire marche arrière, désavouant en septembre 1787 ce qu’il avait lui-même ordonné. Ledoux fut ainsi sacrifié comme bouc émissaire au mécontentement général.
1787 a tout de même été marquée par un petit essai de démocratie locale avec la création d’assemblées municipales d’élus auxquelles appartiennent de plein droit le seigneur et le curé de chaque village. Elles ont essentiellement pour mission d’établir les rôles de taille et des autres taxes. Ce seront ces assemblées municipales qui, en 1789, se chargeront de rédiger les cahier de doléances.
La crise financière n’est toujours pas réglée. Que va faire Louis XVI ?
L’année 1789 commence avec un événement politique majeur, la convocation des États Généraux de toutes les provinces françaises, dont le but était de trouver une solution à la crise financière provoquée par un déficit abyssal des finances royales.

Louis XVI demande donc l’élection de députés,et, sous l’influence de son « directeur général des finances », le banquier Necker, il accepte le doublement de la représentation du Tiers État, qui passe donc à 50 %. Cette décision irréfléchie va faire basculer le régime. Sur les 1 200 députés élus, du fait de quelques transferts, la majorité des sièges est détenue par le Tiers État, les représentants du clergé et les nobles se retrouvant minoritaires.
Un futur Eaubonnais, Philippe-Antoine Merlin, siège comme député du tiers état du bailliage de Douai. Un autre futur Eaubonnais, Michel Regnaud, avocat, est élu pour le bailliage de Saint-Jean d’Angely. Il est intéressant de comparer leurs comportements pendant les dix ans de la Révolution.
Qu’est-ce que le Tiers Etat ?

Les députés du Tiers État sont les représentants des bourgeois qui occupent des professions libérales (médecins, avocats), des notaires, des greffiers, des procureurs, mais aussi des banquiers, des financiers et des fermiers généraux. Louis XVI se doutait-il que son ennemi allait être la finance ?
Les députés du Tiers se déclarent rapidement en Assemblée Nationale constituante.
Louis XVI renvoie alors Necker, tenu pour responsable de cette perte d’autorité, et, pour tenter de contrôler les émeutes, fait appel à des troupes de mercenaires suisses et allemands qui se positionnent autour de Paris. Ceci provoque évidemment la révolte du peuple de Paris, et la prise de la Bastille, le 14 juillet, par des émeutiers qui pensent y trouver des armes. Le roi est contraint à céder, annonce aux député le renvoi des troupes et, faisant encore une fois marche arrière il rappelle Necker. L’autorité de l’Assemblée constituante est reconnue.
Quelle est alors la réaction des nobles ?
La haute noblesse commence à émigrer : le comte d’Artois, le prince de Condé, le maréchal de Boglie, Breteuil, etc, et un sentiment de panique commence à se développer, les autorités locales disparaissent un peu partout et ce vide favorise la peur.
Le prince de Condé, en l’occurrence Louis V de Bourbon-Condé, cousin de Louis XVI et seigneur de la Vallée de Montmorency, émigre après la prise de la Bastille aux Pays-Bas puis à Turin. Il organise à Worms, sur les bord du Rhin, un des trois corps de l’armée des émigrés dont le but est de combattre les troupes révolutionnaires, de libérer le roi et de remettre la monarchie sur le trône. L’armée de Condé se battra jusqu’en 1801, aux cotés de l’Autriche, puis de l’Angleterre, puis de la Russsie. Le prince de Condé ne reviendra en France que lors de la Restauration, en 1814. Il mourra à Chantilly en 1818, à l’âge de 81 ans.
Deux fils de Joseph-Florent Le Normand de Mézières émigrent : Gabriel Joseph et Claude François. Ont-ils rejoint l’armée de Condé ? L’enquête est ouverte.
Comment la nouvelle Assemblée Nationale va-t-elle essayer de résoudre la crise financière qui était à l’origine de tous ces changements ?
Tout d’abord en décrétant la nationalisation des biens du clergé, l’État prenant en charge les frais de culte et un traitement pour les prêtres. Puis, en 1790, on obligea les prêtres à prêter serment d’être fidèles à la nation, au roi et à la constitution civile, les réfractaires étant déchus de leur fonction.
Ensuite par une réforme fiscale. On ne perle plus d’impôts mais de contributions, également réparties entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.
En 1791, considérant sa mission terminée l’Assemblée décide de se séparer et laisse la place à un nouvelles assemblée, la Législative.
Cette nouvelle assemblée accueille un autre futur Eaubonnais, Louis Jérôme Gohier, avocat au Parlement de Bretagne. Il est élu comme député d’Isle et Vilaine.
La crise financière était-elle résolue ?
Non, et donc la nouvelle Assemblée va chercher d’autres revenus en confisquant les biens des immigrés. En novembre 1791, l’Assemblée vote un décret les invitant à rentrer dans un délai de deux mois, sous peine de confiscation de leurs biens et la mort. Le prince de Condé, propriétaire de domaine de Chantilly et du Palais Bourbon, et, plus localement le baron d’Eaubonne, Gabriel Le Normand de Mézières, héritier de toutes ses propriétés eaubonnaises de Joseph Florent, se retrouvent dans cette situation.
Le 7 février 1792 Gohier demande que les biens des émigrés soient mis sous séquestre, et s’élève contre la proposition des les soumettre à une triple contribution :
« Ce n’est pas une contribution patriotique qu’il faut exiger des émigrés rebelles, ce n’est même pas une amende qu’il s’agit de leur imposer, mais bien une peine infamante qu’il faut leur infliger ».
Le domaine de Chantilly, principale résidence des princes de Condé, est mis sous séquestre en juin 1792. Le château, vidé de son mobilier, est occupé par des gardes nationaux. Le parc est mis en vente par lots. Le château commence à être démoli pour récupérer les matériaux de construction. Le Palais Bourbon, également déclaré bien national, sera affecté au Conseil des Cinq Cents, qui deviendra l’Assemblée Nationale.
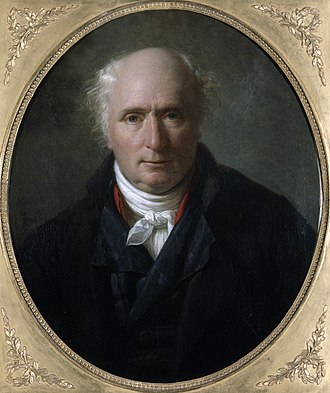
A Eaubonne toutes les propriétés appartenant à la famille Le Normand de Mézières sont mises sous scellés à la mort de Joseph Florent et deviendront biens nationaux. Le château d’Eaubonne, construit à l’image du Petit Trianon de Versailles au cœur de l’actuel quartier de La Cerisaie, sera détruit.
C’est Louis Jérôme Gohier qui rachètera le Petit Château de Le Normand de Mézières et le fils de Merlin de Douai qui en héritera à sa mort.
Quelles sont les réactions à l’étranger ?
Joseph II, roi d’Autriche est le frère de Marie-Antoinette. L’Assemblée Constituante avait voté en 1790 un décret pour rassurer les chancelleries étrangères : « La Nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple ». Hélas l’Assemblée Législative va avoir une vision différente.
Le 21 février 1791, dans Le Moniteur, Louis Gohier défend la nécessité d’une guerre contre Léopold, qui a succédé à son frère Joseph II. En avril 1792, l’assemblée Législative vote finalement l’entrée en guerre. Les Prussiens s’allient alors aux Autrichiens, renforcés par l’armée des émigrés.
La guerre est bien sûr un désastre militaire car la plupart des cadres de l’armée française avaient émigré.
Louis XVI est considéré comme complice des envahisseurs et Août voit la prise des Tuileries par des insurgés et la chute de la monarchie. Les royalistes qui avaient tenté de défendre Louis XVI sont emprisonnés. Deux jours plus tard une rumeur concernant un complot fomenté par ces royalistes emprisonnés provoque la fureur des révolutionnaires qui sortent les prisonniers et les exécutent sommairement. Une circulaire du comité de surveillance, signée par Marat et contresignée par Danton, le ministre de la Justice, appelle à la généralisation des massacres dans toute la France. Il y aura entre le 2 et le 9 septembre, 1 300 morts à Paris et 150 morts dans le reste de la France, les premiers visés étant les prêtres qui avaient refusés de prêter serment à la Constitution civile du clergé (191 religieux victime de ces tueries seront considérés comme martyrs par l’Eglise catholique et béatifiés par Pïe XI en 1926), les aristocrates, les serviteurs des Tuileries, les officiers et sous-officiers des gardes Suisses et les gardes du corps. La Princesse de Lamballe et d’autres proches de Louis XVI sont également assassinés. Le Ministre de la Justice, Danton, le Ministre de l’Intérieur, Roland, l’ensemble des ministres et l’Assemblée observent les massacres sans réagir.
Le 16 septembre 1792, Gohier présente à la Convention un « Rapport sur les papiers inventoriés dans les bureaux de la Liste civile ». Ce texte est un très violent réquisitoire contre Louis XVI, présenté comme responsable de tous les maux de la France et comme un traitre, évoquant des pièces qui prouvaient l’intelligence de la cour avec les puissances étrangères ainsi que les machinations ourdies à l’intérieur pour opérer la contre-révolution. Gohier termine en s’élevant contre la division des forces révolutionnaires, présentée comme une machination du roi. Très brillant, ce discours remporte le succès attendu auprès de l’Assemblée Nationale qui demande qu’il soit imprimé. Il jouera un rôle capital dans le procès de Louis XVI.
L’assemblée législative se sépara le 20 septembre 1792 pour laisser la place à la Convention.
La première décision de cette nouvelle Assemblée, où siègent Merlin de Douai et Gohier, concerne l’abolition de la royauté et la condamnation à mort de Louis XVI par une très faible majorité (365 voix contre 356 dans un premier temps, puis 361 contre 360 après recomptage des voix). Louis XVI est guillotiné dès le lendemain, le 21 janvier 1793. Deux députés, Lanjuinais et Malesherbes, avaient essayé d’obtenir que la condamnation du roi ne soit prononcée qu’à la majorité des 2/3 des votants. Ce fut Merlin de Douai qui s’opposa violemment à cette proposition. Il vota la mort de Louis XVI. Cette décision entraînera sa mise à l’écart par Napoléon Bonaparte de la rédaction du code civil, celui-ci ne souhaitant pas faire participer au projet un régicide. Regnaud de Saint-Jean d’Angély avait par contre rejoint le groupe des royalistes décidés – comme le poète André Chénier avec lequel il se lie – à peser sur la décision de certains conventionnels dans le procès du roi.
L’Assemblée va-t-elle faire quelque chose pour éviter que se reproduisent d’autres massacres ?
Le 10 mars 1793, pour tenter de rétablir son autorité et éviter que se renouvelle l’expérience de la perte de contrôle de l’exécutif lors des massacres de septembre, l’Assemblée de la Convention se réunit pour discuter de la création d’un Tribunal criminel extraordinaire – plus tard appelé Tribunal révolutionnaire – pour « juger sans appel et sans recours les conspirateurs et les contre-révolutionnaires ».
Ce nouveau tribunal va devenir l’outil de l’exécutif jusqu’à la chute de Robespierre. Il va juger 5.215 accusés et en envoyer 2.791 à la guillotine.
Le 20 mars 1793 Gohier est nommé ministre de la Justice. A ce titre il envoie à la Convention, le 17 juin, la liste des députés girondins arrêtés ou en fuite.
Le 17 septembre 1793 est votée, sur rapport de Merlin de Douai, la loi des suspects. Sont réputés suspects les partisans de la tyrannie et du fédéralisme, ceux qui n’ont pas le certificat de civisme, les fonctionnaires destitués, les ci-devant nobles, les émigrés, et, de façon générale, « ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la liberté ».
Dans toute la France la répression par l’armée de la Convention peut être assimilée à un véritable génocide, avec, selon les estimations 100 000 à 250 000 morts. Regnaud de Saint-Jean d’Angely est obligé de se cacher sous une fausse identité.
Gohier était toujours ministre de la justice !
Pendant cette période de Convention Montagnarde le Tribunal Révolutionnaire envoya à la guillotine de nombreux « opposants » parmi lesquels: Charlotte Corday, Marie-Antoinette, Brissot, Vergniaud, Olympe de Gouges, le duc Philippe d’Orléans (Philippe-Egalité), Madame Roland, Madame du Barry, Danton, Desmoulins, Antoine Lavoisier, Madame Elisabeth, 26 administrateurs du Finistère, 54 « Chemises Rouges », 16 religieuses Carmélites à Compiègne, le Comte Alexandre de Beauharnais et Frédéric II, prince de Salm, les poètes André Chénier et Jean-Antoine Roucher,
an II (29 germinal) : Lorsque les ministères furent remplacés par des commissions exécutives, Gohier renonça à ses fonctions au sein du gouvernement et accepta un poste de président au Tribunal criminel de la Seine.
Gohier avait-il renoncé définitivement à la vie politiques ?
Bien sûr que non ! Candidat au Directoire au moment du coup d’État de fructidor, il est finalement élu directeur, le 18 juin 1799, en l’emplacement de Treilhard dont la nomination était annulée. Il est aussitôt nommé président du Directoire, charge qu’il n’occupera qu’un peu plus que 2 mois.
En effet le 9 septembre 1799, après le coup d’État de brumaire, BONAPARTE charge un de ses proches « d’obtenir» » la démission de Gohier. Celui-ci s’empresse d’acquiescer. Consigné un moment au Luxembourg, il se retire dans sa propriété d’Antony, prés de Sceaux.
En 1802 NAPOLÉON nomme Gohier « commissaire général des relations commerciales de l’Empire français en Batavie», en d’autres termes, consul de France à Amsterdam. Il occupe ce poste jusqu’à la réunion de la Hollande à la France, refusa par raison d’âge et de santé la même situation aux États-Unis. C’est donc aux Pays-Bas que, en 1806, Louis Gohier marie sa fille unique au général François Eugène Merlin, fils de Merlin de Douais.
En 1810 il se retire à Eaubonne, dans un ancien château de Le Normand de Mézières, où il se livre à la culture des lettres. Il mourra à Eaubonne le 29 janvier 1830 et y sera enterré. C’est toujours à Eaubonne que son gendre, le général Merlin décèdera et sera enterré, en 1854. Héros de la bataille de Leipzig en 1813, Chevalier de l’Empire, Grand officier de la Légion d’honneur, Chevalier de Saint-Louis, il a son nom gravé sur l’Arc de Triomphe de l’Étoile.
Et Regnaud ?
Après la campagne d’Égypte Bonaparte remarque les talents de Regnaud de Saint-Jean d’Angely qui devient son éminence grise. Regnaud s’installe à Eaubonne en 1800, dans le château du poète-académicien Saint-Lambert. Il quittera Eaubonne en 1806 pour s’installer à l’Abbaye du Val, à Mériel, dont il entreprendra la restauration après les destructions de la période révolutionnaire. Son fils, le comte Auguste Regnaud de Saint Jean d’Angely, maréchal de France, héros de la campagne d’Italie de 1859, a son nom gravé dans la crypte de l’église Saint Louis des Invalides.