[article de Jean Veillon- repris de l’ancien site du cercle ]

Michel Mourre est né à Eaubonne le 11 juin 1928. Son père, architecte, y a construit l’hôpital et le groupe scolaire Paul-Bert. Parmi les ancêtres de Michel, on trouvait du côté de sa mère, née Edmée Allard, des royalistes et une ascendance de noblesse incertaine revendiquée par sa grand-mère. Du côté paternel, il y avait des radicaux, des francs-maçons et un arrière grand-père communard. Mourre a vécu ses douze premières années dans la maison construite par son père, boulevard du Petit Château, et il a fait ses premières études à l’école Jules-Ferry. Après la mort de sa mère, en 1940, il a rejoint sa grand-mère à Paris. Son père, mobilisé en 1939, fut démobilisé en 1940 à Montpellier. Il y resta et s’y remaria. La maison d’Eaubonne fut alors vendue.
Entré à Jeanson de Sailly, Mourre y eut Paul Guth pour professeur. En 1943, à 15 ans, il militait pour Doriot et distribuait des tracts au lycée. Dénoncé à la Libération, il fut incarcéré pendant quelques jours et, bien qu’il ait bénéficié d’un non-lieu, cette affaire d’épuration lui valut d’être exclu de Jeanson de Sailly et le contraignit à travailler. On l’a vu successivement, entre 1945 et 1948, au ministère de la Reconstruction, dans une banque et dans une agence immobilière. Parallèlement à ces activités alimentaires, il lisait Nietzsche, Barrès, Bernanos, Maurras, et découvrait l’Eglise catholique, dont son père l’avait tenu éloigné. En 1946, à 18 ans, il tint à recevoir le baptême.
Dans le même temps, il rejoignait l’Action Française, militait au PRL (Parti Républicain de la Liberté), et s’activait beaucoup. C’était l’un des « agités » de Saint-Germain des Prés. On le voyait au Biarritz, au Dupont Latin, à La Reine Blanche, entouré d’admirateurs. Il lisait les philosophes, les romantiques allemands, Maritain, Henri Massis, et collaborait à La Nation Française. En découvrant Saint Thomas d’Aquin, il se sentit de plus en plus attiré par la foi monastique. À Paris, il entra en contact avec le couvent de Dominicains de la rue Saint-Honoré et avec le maître des novices du couvent dominicain de la rue de la Glacière. Son père lui obtint une retraite au couvent des Dominicains de Montpellier. Il en fit une autre à Toulouse. C’est à cette époque qu’il est venu pour la dernière fois à Eaubonne revoir le quartier de son enfance et rendre visite à M. et Mme Vallette. À l’issue de leur rencontre, il les avait presque convertis.
En 1948, à 20 ans, ne pouvant échapper au service militaire, Mourre devança l’appel. Après quelques mois passés en Allemagne, réformé pour insuffisance cardiaque, il fut libéré de l’armée. En 1949, il entra pour un essai de noviciat au couvent des Dominicains de Saint-Maximin, en Provence. Déçu par cette expérience, il n’y donna pas suite. Sa vocation ecclésiastique s’est arrêtée là.
Rentré à Paris sans ressources, il y mena pendant quelques temps une vie de SDF, dormant sur les pelouses du Champ de Mars et se réfugiant, quand il pleuvait, sous l’entrée de l’aquarium du Trocadéro. Bien vite, il obtint un poste de lecteur chez un éditeur et retrouva Saint-Germain des Prés, le Mabillon, le Saint-Claude, et son audience, jusqu’à ce fameux dimanche de Pâques 1950. M. Arthur Comte, qui l’avait croisé à cette époque, l’avait trouvé très « dynamique » ! Scandale à Notre-Dame de Paris le dimanche 10 avril 1950 ! Alors que Mgr Feltin, archevêque de Paris, célébrait l’office de Pâques, Michel Mourre, vêtu en dominicain, est monté en chaire pour clamer : « J’accuse l’Église catholique d’infecter le monde avec sa doctrine mortuaire. Je l’accuse de détourner les forces vives au profit d’un ciel vide. Je l’accuse d’être le chancre de l’occident »… Le tumulte fut énorme. Au pied des marches, ça se bousculait ferme. La police, appelée en urgence, eut le dernier mot. Mourre fut arrêté. Le lendemain, le Parisien libéré titrait sur deux colonnes à la une « Scandale à Notre Dame » et parlait d’un ancien novice dominicain. France-Soir le traitait de faux moine et le Figaro de déséquilibré en robe de bure. La Croix le qualifiait de perturbateur et le décrivait comme un individu venu des caves des zazous de Saint-Germain des Prés. Le mercredi suivant, le Canard Enchaîné prônait en représailles une descente de curés de choc au Tabou.
Le scandale de Notre-Dame mit fin au Mourre exubérant de Saint-Germain des Prés. Désormais, il allait s’enfermer dans sa bibliothèque (mais pas tout seul, avec une ancienne Miss Europe) et écrire. Son premier ouvrage, Malgré le blasphème (Julliard, 1951), où l’on décelait les doutes intellectuels, politiques et religieux qui étaient les siens et ceux de sa génération, commençait mal. Dès les premières lignes, il racontait que deux camarades étaient venus chez lui, qu’ils avaient cassé deux wagons de son train électrique et englouti un pot de confiture. Et le comble, c’était que le soir, au dessert, il avait laissé échapper « un vilain mot » ! Ses parents, qui « aimaient le peuple, mais pas assez pour laisser prendre à leur fils des manières de gosse d’ouvrier … se reprochaient d’avoir levé, pour un jour, la consigne de solitude où ils (le) gardaient pour éviter les mauvaises fréquentations ». Il ne manquait pas d’air, cet hypocrite de Mourre, en écrivant cela. L’un des deux garçons était Jean-Pierre Ferrière. L’autre, c’était moi. Nous n’étions ni l’un ni l’autre des « racailles » et il n’avait pas attendu ce jeudi de 1938 pour apprendre les « vilains mots » qu’il entendait et employait tous les jours à l’école depuis quatre ans !
Nous avions goûté sous les yeux soupçonneux et méprisants de la grand-mère qui ne nous avait pas fait un sourire de la journée, mais nous n’avions pas vidé le pot de confiture. Si quelqu’un l’a fait, ce n’est ni Jean-Pierre ni moi. Alors qui ? Il s’agissait pour Mourre et la grand-mère de décider les parents à ne pas renouveler l’expérience… Malgré le blasphème était un grand acte de contrition, où Mourre cherchait à se justifier du scandale de Notre-Dame. Il y accablait tellement sa famille et en particulier son père, qu’en comparaison, ses propos à notre encontre étaient très modérés.
Le 10 février 1951, Michel Mourre épousa Ariane Guédionoff. Leurs témoins étaient la comédienne Hélène Duc et son mari. Ariane, qui venait de Russie, avait été Miss Europe. Mme Duc raconte dans Entre Cour et Jardin (Pascal, 2005) que son amie Ariane avait vingt ans de plus que Michel et était divorcée d’un M. Pathé. Échotière à Samedi Soir, c’était une femme très belle, très élégante et l’une des figures en vogue de Saint-Germain des Prés. On lui prêtait des amitiés célèbres : Claude Mauriac, Eisenhower… Elle était cultivée et aimait s’entourer d’œuvres précieuses et d’amis talentueux. Elle avait été subjuguée par la fougue de ce grand dominicain et en était tombée éperdument amoureuse. Fut-elle l’inspiratrice de l’intervention sulfureuse à Notre-Dame ? Est-ce pour elle que Mourre a renoncé à sa vocation ? Il n’en dit rien dans Malgré le blasphème, écrit alors qu’ils vivaient ensemble et il semble bien qu’il avait pour motivation essentielle ses griefs vis-à-vis d’une organisation religieuse qui l’avait déçu. Après leur mariage, Ariane était revenue à son métier d’infirmière de nuit pour permettre à Michel d’écrire. Ainsi, Mourre retrouvait l’ambiance de son enfance. Une femme s’occupait de toutes les contingences matérielles, comme autrefois sa mère et sa grand-mère et il pouvait se concentrer, à l’écart du monde, à ses recherches et à ses travaux littéraires. N’était-ce pas ce qu’il avait vainement recherché dans une vie monastique ? Michel et Ariane ont divorcé dix ans plus tard. Dans deux de ses premiers ouvrages, Charles Maurras (Ed. universitaires, 1953), et Lamennais ou l’hérésie des temps modernes (Amiot Dumont, 1955), Mourre racontait la vie de deux personnages qui l’ont fortement influencé. Une grande partie de son œuvre littéraire : Les religions et les philosophies d’Asie (Table ronde, 1963), Le monde vivant des moines (Centurion, 1965), Le socialisme, de la lutte des classes à l’état socialiste (Lib. Universitaire, 1974), a par la suite reflété sa quête de vérité politique, philosophique et spirituelle. Après quelques articles sur les œuvres (1955), sur les auteurs (1958)et sur les personnages (1960) dans des dictionnaires, il entreprit de raconter l’Histoire du monde en dix étapes. La première fut Le monde à la mort de Socrate, en 399 av. J.C. (Hachette, 1961). La deuxième fut Le monde à la naissance du Christ (Hachette, 1962). L’une et l’autre sont remarquables, mais il n’y eut pas d’étape suivante. Il avait pourtant projeté de nous montrer le monde sous la ruée des barbares (en 410), au temps de Charlemagne (en 800), au temps de Gengis Khan et de saint Louis (de 1200 à 1300), à l’embarquement de Christophe Colomb (en 1492), au temps de Versailles et de Pierre le Grand (en 1700), au temps de Valmy (en 1792), le monde de l’homme blanc (en 1880) et le monde à l’heure de Munich (en 1938), mais la maladie ne lui en a pas laissé le temps. Depuis 1961, il dirigeait « Le Dictionnaire du Monde Moderne », aux Éditions Universitaires.
En 1968, il publia un Dictionnaire d’Histoire Universelle en 2 vol. (Éd. Universitaires), première version de la grande encyclopédie qu’il allait développer au cours des années suivantes.
Après « Vingt cinq ans d’Histoire Universelle, 1945-1970 » (Éd. universitaires, 1971), qui jette un rapide coup d’œil sur notre temps, il publia en 1972 un Dictionnaire des personnages historiques de tous les temps (Bordas). En 1977, Mourre mit un point final à la rédaction de son Dictionnaire Encyclopédique d’Histoire, en 8 volumes (Bordas). Ce fut aussi le point final de son existence. Le 6 août 1977, il succomba à une tumeur cérébrale. Il avait 49 ans.
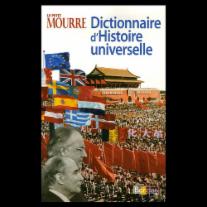
La première édition du Dictionnaire Encyclopédique d’Histoire, de Michel Mourre, est sortie en 1978. Il ne l’a jamais vue. Comme il en était convenu avec l’éditeur, le « Mourre » est réédité chaque année, avec une mise à jour qui tient compte de l’évolution de l’Histoire. Il en existe une version condensée en un volume, et depuis 2004, une version sur CD-Rom.
Le 16 décembre 1965, Michel Mourre épousa Marie-Thérèse de Montfalcon, qui lui donna une fille, Frédérique. Son petit-fils, qu’il n’a pas connu, se prénomme Antoine. Jean Mourre, son père, est mort à Montpellier en 1982. Quand l’école Jules-Ferry est devenue la bibliothèque municipale, je fus étonné qu’elle portât le nom de Maurice Genevoix, un immense écrivain, et non celui de Michel Mourre, qui avait vécu là ses premières années et qui repose à Eaubonne, à proximité de sa mère. Je m’en suis ouvert à M. André Petit, qui était maire à l’époque, et à Mme Michèle Andro, qui était chargée des affaires culturelles. J’ai aussi consulté les autorités religieuses pour avoir l’agrément de l’église. Il fut décidé de donner le nom de Mourre au square qui jouxte la bibliothèque. Le jeune Michel y avait joué autrefois, et c’était maintenant un terrain de jeux pour les enfants. M. Petit a tenu à associer à l’hommage rendu au fils le nom de son père, Jean Mourre, l’architecte. Il est heureux qu’ils aient été réunis en cette occasion, car au-delà des conflits idéologiques ou familiaux qui les ont séparés pendant des années, ces deux hommes avaient beaucoup d’estime et d’admiration l’un pour l’autre.
Jean Veillon,
Extrait du livre « Souvenirs d’Eaubonne au XXème siècle », de Jean Veillon.