
Élisabeth Sophie Françoise Lalive de Bellegarde, née à Paris le 18 décembre 1730, est couramment prénommée Sophie. A 17 ans, elle épouse, le 28 février 1748, contre son gré, Claude Constant César, comte d’Houdetot (1724-1806), qui a 22 ans et sert dans l’armée. Ce mariage est un arrangement de famille. M. d’Houdetot a déjà une relation avec une femme mariée, fait habituel dans la haute société du XVIIIème siècle, où les femmes n’ont souvent pas leur mot à dire. Cette liaison durera 48 ans après son mariage. Pendant trois ans, Mme d’Houdetot s’accommode avec résignation des façons de son mari.
Puis, à la fin de 1751, elle fait la connaissance de Jean-François de Saint-Lambert (1716-1803), militaire de carrière et académicien.

crédit; Académie francaise
C’est le début d’une liaison qui durera 51 ans, un record de fidélité extra-conjugale. Comme le rapporte Rousseau dans les Confessions, « elle trouva dans M. de Saint-Lambert tous les mérites de son mari, avec les qualités plus agréables, de l’esprit, des vertus, des talents. S’il faut pardonner quelque chose aux mœurs du siècle, c’est sans doute un attachement que sa durée épure, que ses effets honorent, et qui ne s’est cimenté que par une estime réciproque ».
L’installation à Eaubonne
Mais bientôt, un événement important vient troubler cette paisible harmonie : la guerre de sept ans (29 août 1756 – 15 février 1763 : France et Autriche et leurs alliés contre Angleterre et Prusse et leurs alliés). Tous les officiers sont requis pour le service de l’armée royale et c’est ainsi qu’au début de 1757, le comte d’Houdetot et Saint-Lambert partent en campagne, de même que Friedrich Grimm (1723-1807), l’homme de lettres ami de madame d’Épinay.
C’est probablement pour ne pas être trop éloignée de sa belle-sœur (1), pendant l’absence de son mari que Sophie d’Houdetot vient s’installer à Eaubonne, au début du mois de mai 1757, dans une dépendance du château de Meaux, qui deviendra au XXème siècle le château de la Chesnaie. C’est madame d’Épinay qui se charge des formalités de location, lors d’un bref séjour qu’elle fait dans la Vallée de Montmorency dans la semaine du 14 au 21 avril 1757, alors qu’elle tient encore ses quartiers d’hiver à Paris.
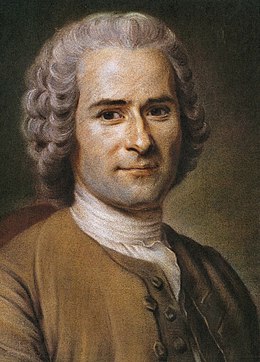
L’incroyable passion de Rousseau pour son amie eaubonnaise
À peine installée dans sa « petite maison » eaubonnaise, vers le 12 mai, Sophie d’Houtetot se rend à Montmorency, pour rencontrer Rousseau, qui habite l’Ermitage depuis le 1756 et dont elle a fait la connaissance lors de son mariage en 1748. Elle est déjà allée le voir le 9 janvier, en plein hiver, sans que cette rencontre, qui a pris un tour rocambolesque, émeuve de manière particulière l’austère philosophe montmorencéen. Mais cette fois-ci, Rousseau tombe amoureux fou de sa visiteuse, au point de déclarer plus tard dans ses Confessions que Madame d’Houdetot aura été « l’unique amour de sa vie ».
Déclaration étonnante quand on connaît les rapports tumultueux que Rousseau a entretenus avec la gent féminine ! L’amoureux transi déclare sa flamme à l’occasion d’une troisième visite de Sophie quelques jours plus tard. Surprise, celle-ci le repousse dans un premier temps, car elle entend rester fidèle à Saint-Lambert.
Mais comme Rousseau lui donne des gages de respect envers son amant parti à la guerre, elle consent à se laisser courtiser « en tout bien tout honneur », et les deux vivent pendant trois mois une idylle singulière, ponctuée par de romantiques promenades le long des coteaux de la forêt de Montmorency, et par quatre ou cinq séjours à Eaubonne.

C’est au cours d’un dernier séjour dans la « petite » maison de Sophie, le 5 juin 1757, que se déroule la scène mythique de l’acacia près d’une cascade édifiée par la comtesse à la demande de Rousseau sur le ru qui borde la propriété. Cette scène, rapportée par le philosophe dans le livre X des Confessions, marquera à ce point les esprits qu’en 1789, les habitants de Montmorency viendront cueillir un rejeton de l’acacia pour planter un arbre de la liberté à l’entrée de leur ville. Indiquons que cette cascade est encore visible de nos jours dans une propriété eaubonnaise donnant sur l’avenue portant le nom de Jean-Jacques Rousseau.
Cette idylle sera refroidie par le retour impromptu de Saint-Lambert au début du mois de juillet, probablement prévenu par Madame d’Épinay, jalouse de l’attention trop marquée que son protégé porte à sa belle-sœur. Même si Saint-Lambert ne se formalise pas trop de cette amitié renforcée, Sophie d’Houdetot reprend ses distances et Rousseau en tombe malade. Il impute cette rupture à Madame d’Epinay et décide de quitter l’Ermitage le 15 décembre. Un mécène, apprenant les soucis de l’écrivain, propose de l’héberger.
Les deux voisins valmorencéens
Mme d’Houdetot reste à Eaubonne jusqu’en 1762, date à laquelle les d’Houdetot déménagent à Sannois et Saint-Lambert s’installe… à Eaubonne, dans la villa construite par l’architecte Ledoux pour le compte de Le Normand de Mézières et que l’on appelle aujourd’hui « le château Philipson ».
Les deux amants vivent donc à trois kilomètres l’un de l’autre pendant 35 ans, jusqu’au moment où Saint-Lambert, devenu infirme, est accueilli par M. et Mme d’Houdetot… à Sannois, en 1797. Durant cinq années, ce curieux « ménage à trois » fonctionne dans des conditions honorables, que décrit Mathieu Molé dans ses « Souvenirs d’un témoin de la Révolution et de l’Empire ».
Les dernières années de sa vie
Après le décès de Saint-Lambert, la comtesse d’Houdetot, qui ne pouvait se passer d’amitié et de tendresse, noue vers 1807 une relation affectueuse avec le célèbre homme politique italien, Giovanni Battista de Sommariva (1760-1826), qui a acheté la propriété de Madame d’Épinay.
Elle meurt le 28 janvier 1813 dans sa demeure parisienne du 12 rue de Tournon, et elle est inhumée à Paris au cimetière de Montmartre, 21ème division, face à la tombe d’Alexandre Dumas et à côté de celle de son petit-fils, Frédéric-Christophe d’Houdetot, préfet et pair de France (1778-1859), qu’elle avait élevée suite au décès prématuré de sa mère.
(1) Louise Tardieu d’Esclavelles est mariée à son cousin germain, Denis-Joseph Lalive, marquis d’Épinay (1724-1782), frère de Sophie d’Houdetot, née Lalive de Bellegarde.